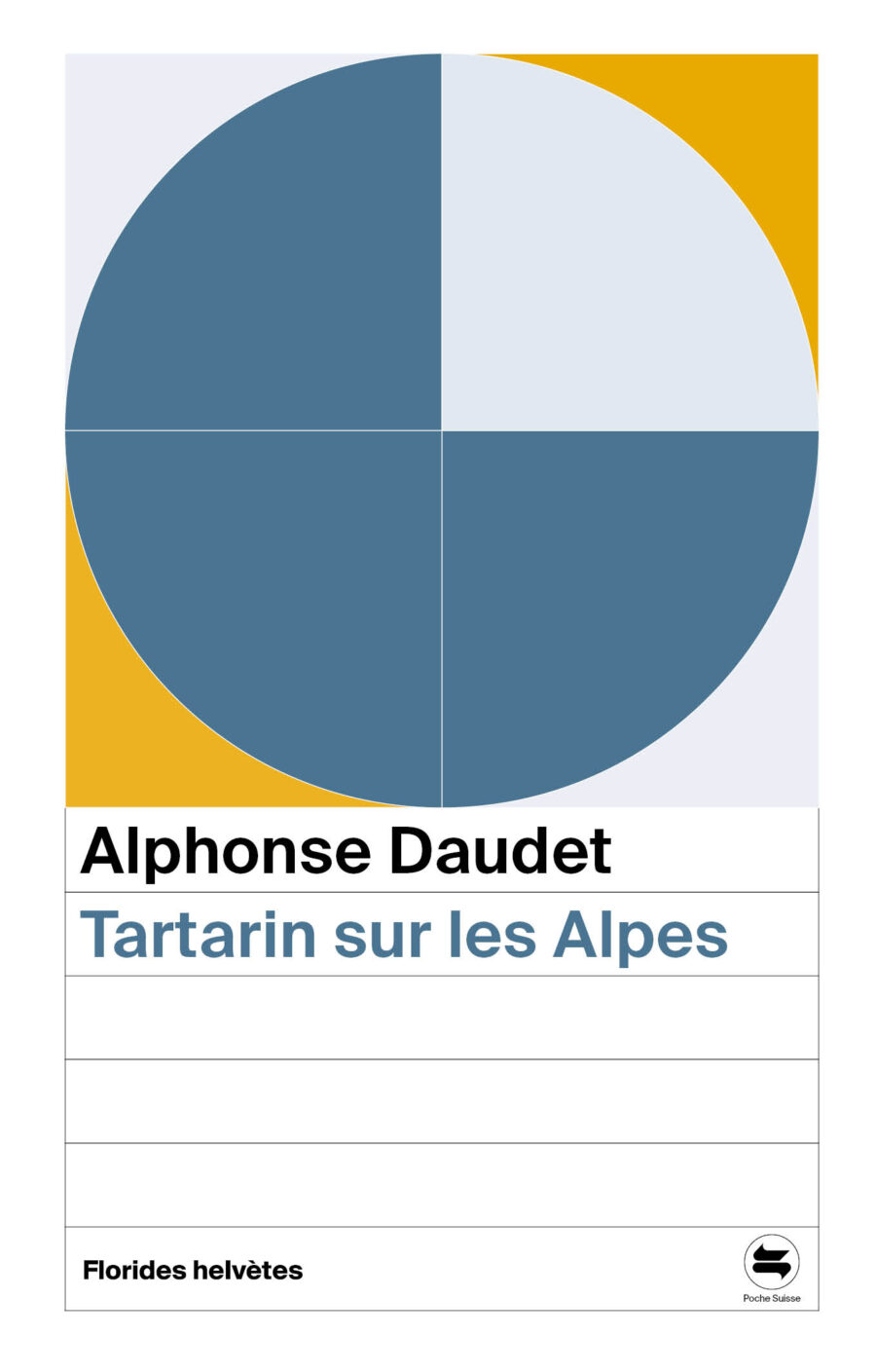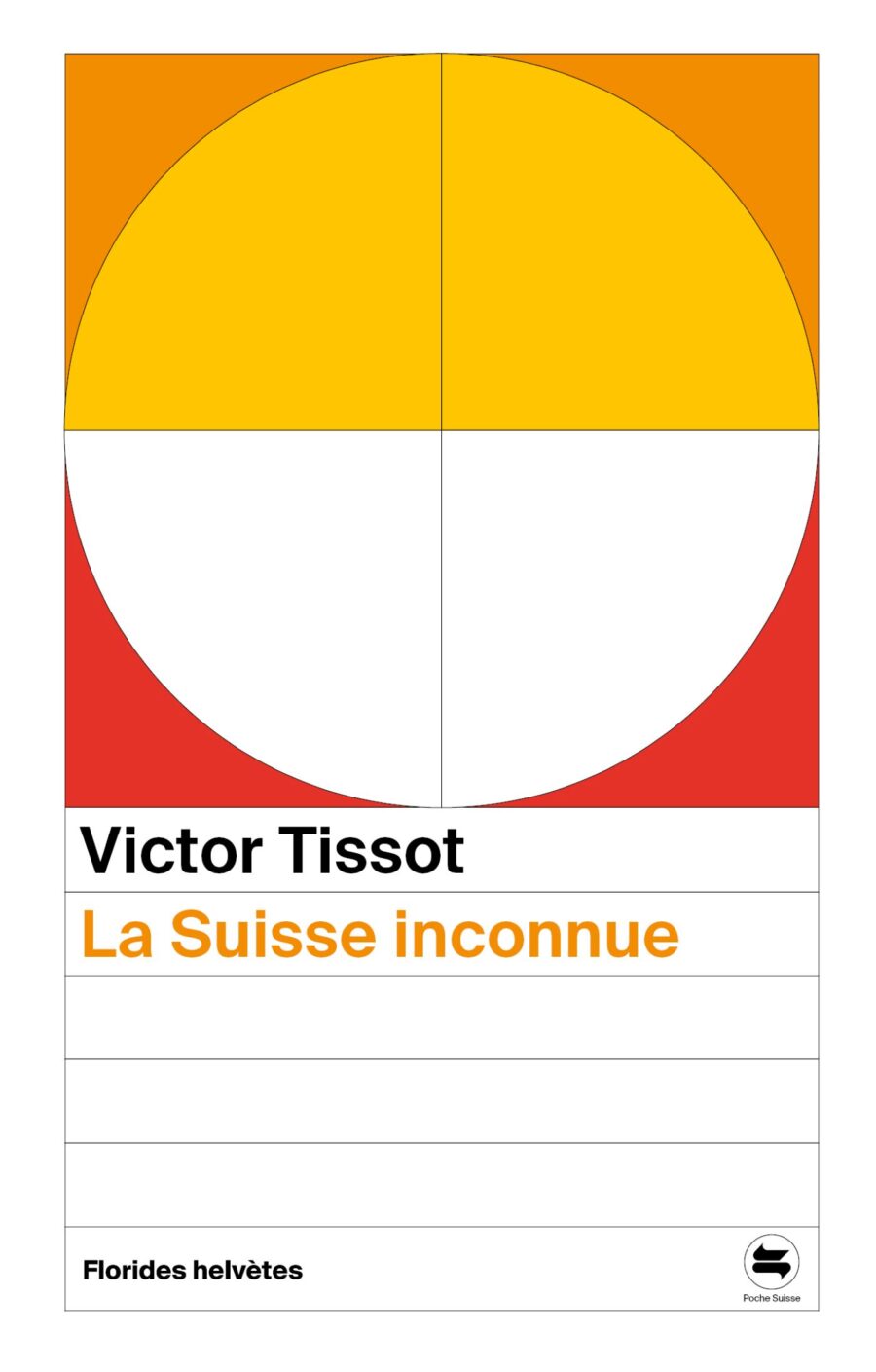César Ritz. La vie d'un hôtelier de légende
Préface : Meyer Audrey
César Ritz. La vie d’un hôtelier de légende nous plonge au plus près de la création d’un univers devenu mythique et du couple qui a fait de l’hôtellerie un grand art.
Créateur d’un univers aussi luxueux qu’intemporel, entrepreneur visionnaire, César Ritz (1850-1918) a révolutionné en quelques années l’art de l’hôtellerie. Avec son épouse Marie-Louise (1867-1961), il formait un fabuleux duo qui mêlait sens des affaires et sens du style à un art sans pareil pour flairer l’air du temps et répondre aux attentes d’une société en rapide évolution.
Lorsque la maladie arrête César dans sa course, Marie-Louise poursuit seule l’aventure avec une détermination peu commune et la farouche volonté de perpétuer les traditions et le « mythe Ritz ».
Dans les années 1930, elle décide de mettre par écrit l’étonnant destin de son époux et l’aventure unique qu’ils ont partagée. Ses mémoires paraissent en anglais en 1938, puis en 1939 en allemand. Le texte en français sera publié en 1948 seulement (Paris, Jules Tallandier), dans une version tronquée.
La présente édition reprend le texte en français, revu et complété au regard de l’édition en anglais. Elle est accompagnée d’une préface d’Audrey Meyer, collaboratrice à l’université de Lausanne et passionnée d’histoire du tourisme.
Auteur: Marie-Louise Ritz
Genre: Regards d’ailleurs
Date de publication : 9 octobre 2025
Longueur : 384 pages
ISBN: 9782940775507
Également en format numérique
PDF: 9782940775514
EPub: 9782940775521
Vertigo/RTS – Isabelle Falconnier, 28 novembre 2025
Un document fantastique, tourbillonnant et foisonnant, un journal intime parfois très émouvant.
Echo Magazine – Thibaut Kaeser, 4 décembre 2025
La précieuse collection «Poche Suisse» de Florides helvètes, qui puise dans les choix passés de Vladimir Dimitrijevic chez l’Âge d’Homme tout en les complétant de nouveaux titres, propose un texte passionnant de plus: César Ritz. La vie d’un hôtelier de légende. Aujourd’hui préfacé par Audrey Meyer, spécialiste de l’histoire du tourisme, cet ouvrage de 384 pages fut publié en 1938 par Marie-Louise Ritz, épouse et collaboratrice du fameux hôtelier haut-valaisan. Elle le fit quand elle réalisa que son mari était frappé par la maladie. Son texte entretient le mythe de l’hôtelier légendaire. Mais son caractère hagiographique n’est pas surfait. On y lit une myriade d’anecdotes et d’épisodes permettant de se faire une juste idée de l’œuvre de Ritz.
Luxe, calme et volupté, poétisait Baudelaire. Luxe, calme et intemporalité, aurait pu certifier le père de l’hôtellerie cinq étoiles.
Loisirs.ch Magazine – Joëlle Brack, 11 décembre 2025
Une vie hors norme qui se lit comme un merveilleux roman.
En ces temps lointains, tous ceux qui en avaient les moyens allaient au bord de la mer en hiver et à la montagne en été. Le ski était presque inconnu, sauf en Scandinavie, et on ignorait encore les bienfaits du sport ou des rayons ultraviolets. L’été, on se rendait donc en Suisse, l’hiver, on se tournait vers l’Égypte ou la Riviera et entre deux, on invoquait sa santé et on faisait une «cure» dans quelque ville d’eaux. On fuyait la chaleur comme le froid tout en recherchant les plus beaux points de vue. Le Kodak et les cartes postales illustrées n’étant pas encore en circulation, on peignait des aquarelles et on écrivait de longues lettres.
Nice était à la mode. Il était nécessaire, pour être considéré comme «quelqu’un», d’y passer au moins une saison ou deux et chaque année, du début du mois de décembre à la fin du mois d’avril, la Promenade des Anglais regorgeait de gentlemen portant favoris et chapeaux de soie et de dames aux longues traînes et aux ombrelles inclinées. C’était l’époque romanesque où les hommes citaient Victor Hugo, Chateaubriand, Byron ; où les femmes ne sortaient jamais sans quelques flacons de sels en prévision des «vapeurs» que pourrait leur causer une émotion trop violente. On ne jurait que par les couchers de soleil flamboyants, les océans tumultueux, les montagnes aux crêtes déchiquetées. Victor Hugo s’était fait construire un observatoire vitré dans son ermitage de Guernesey et il y demeurait en extase pendant des heures, les jours de tempête.
Hélas, la Méditerranée si bleue était habituellement calme, mais c’était une mer qui pouvait devenir puissante. On aimait à se promener sur ses bords et à déclamer des vers tels que ceux-ci : «Roll on, thou deep and dark blue Ocean – roll ! / Ten thousand fleets sweep over thee in vain.» Puis on rentrait à l’hôtel pour lire les dernières éditions des journaux allemands, français ou anglais qui, neuf fois sur dix, insistaient sur la «Nécessité d’Accroître la Flotte de Guerre.»
Les hommes arpentaient la Promenade en citant les poètes ou en parlant politique. Et les dames brodaient ou cousaient. «Que diable peuvent-elles faire de ces mètres de dentelles, de ces kilomètres de broderies, de ces hectares de dessins ?» me demanda une fois César. Peut-être avaientelles entendu dire «que le malin trouve du travail pour les mains oisives», lui ai-je répondu – de telles maximes avaient encore cours en ces temps reculés. Je l’interrogeai à mon tour : n’avait-il jamais entrevu les dessous que ces dames portaient alors ? Il en convint sans rougir : nous nous étions mariés un peu plus de dix ans après la période que je décris et les modes n’avaient guère changé. Et donc, ces dames brodaient et cousaient, dans les salons privés, dans leur chambre, dans les salles de bal. Elles brodaient dans les jardins publics en écoutant l’orchestre. Elles brodaient…
Mais elles mangeaient peu, à tout le moins en public. Les chefs se tordaient les mains de désespoir : «Si cela continue, si les femmes persistent à vouloir maigrir et ensuite à rester sveltes, notre métier est fichu ! Nous nous creusons la cervelle pour inventer de nouvelles sauces et qu’arrive-t-il ? Elles demandent des légumes cuits à l’eau !» Les messieurs se chargeaient toutefois de rétablir l’équilibre. Pour eux, un repas consistait en une solennelle succession de plats passant de la gibelotte de lapin au poulet et du poulet au rosbif, le tout abondamment arrosé de puissants bourgognes. Avant la season de Londres ou la Grande Semaine de Paris, ils trouvaient souvent quelques semaines à consacrer à un «spa» quelconque, disons à Baden-Baden.
Et l’été, on migrait en Suisse.